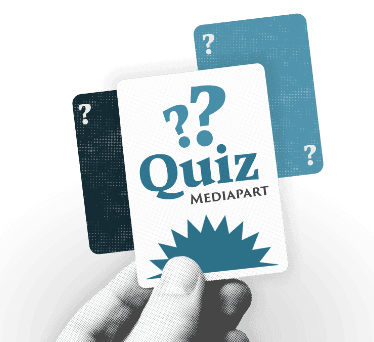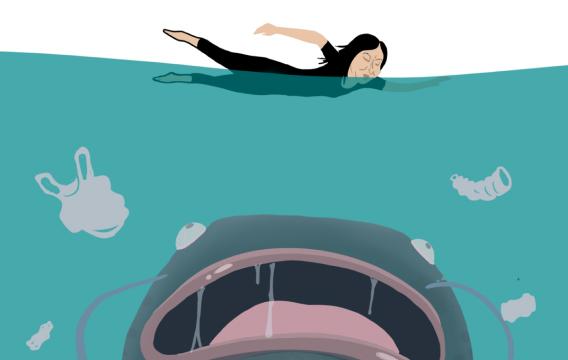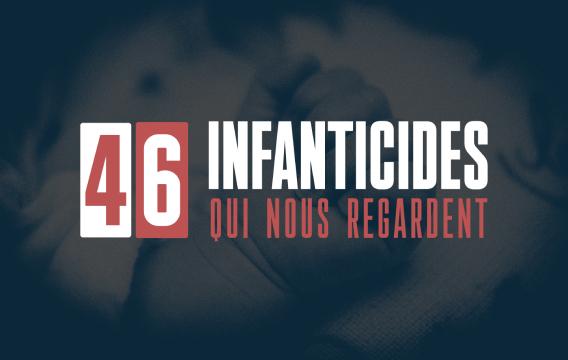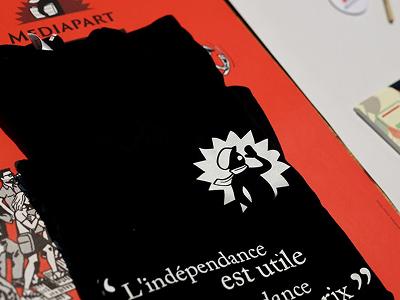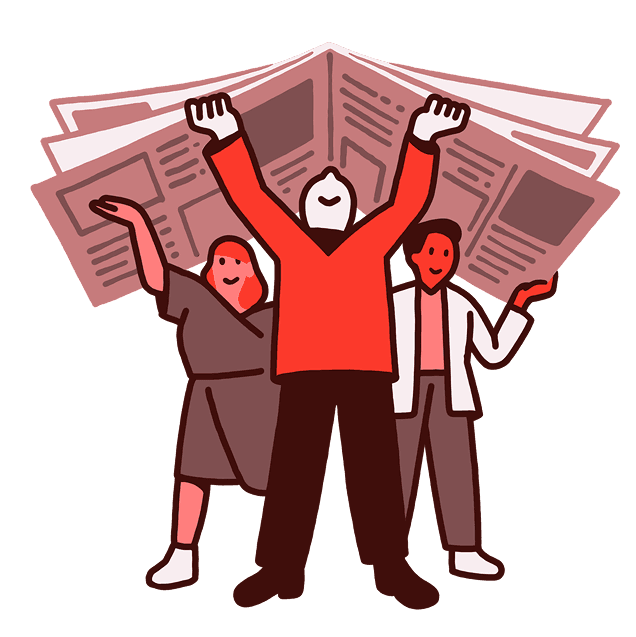Rapport d’impact
Notre utilité, votre combativité
La liberté d’informer est en danger. Après avoir qualifié les journalistes d’« ennemis du peuple » pendant sa campagne, le nouveau président états‑unien a commencé à bannir celles et ceux qui ne se plient pas à sa novlangue. Ainsi, les reporters de l’agence de presse Associated Press se voient interdire l’accès à la Maison-Blanche au motif qu’ils refusent d’appeler le golfe du Mexique « golfe d’Amérique », comme l’exige Donald Trump. « Ils ne nous font pas de faveurs, alors j’imagine que je ne vais pas leur faire de faveurs », se justifie-t-il, comme si le rôle des journalistes était d’être à son service.
« Les mots peuvent être de minuscules doses d’arsenic, on les avale sans y prendre garde, ils semblent ne faire aucun effet et voilà qu’après quelque temps, l’effet toxique se fait sentir », avertissait Victor Klemperer, dans LTI, la langue du IIIe Reich, ouvrage paru en 1947 dans lequel le philologue juif allemand analysait la manière dont la barbarie s’empare du langage pour détruire une société de l’intérieur.
En France également, le poison de la désinformation et du mensonge s’infiltre dans nos vies. Alors que l’ombre fascisante de Trump, allié aux forces de la tech, grandit sur l’Europe, l’exécutif laisse l’extrême droite pourrir les fondements de l’État de droit. Le RN et ses comparses n’ont certes pas obtenu la majorité à l’Assemblée nationale, après la dissolution décidée par Emmanuel Macron, grâce à une mobilisation citoyenne sans pareille.
Voir la suite de l’éditorial
Mais leurs obsessions xénophobes, racistes, sexistes, antisociales, climaticides et antidémocratiques rencontrent de moins en moins de résistance dans l’espace politico-médiatique, au risque de façonner la perception du monde de millions de Français·es, et potentiellement leur vote : elles monopolisent les antennes de la galaxie Bolloré, tirant de leur côté les médias mainstream, et trouvent des relais jusqu’au sein du pouvoir, à l’image du premier ministre François Bayrou qui, contre toute réalité statistique, brandit la menace d’une « submersion migratoire ».
Les valeurs d’égalité, de solidarité et de justice, portées par la Révolution française, et devenues, après la Seconde Guerre mondiale, le socle des traités régissant le droit international, sont dénigrées. Les principes d’intégrité territoriale et de droit des peuples à disposer d’eux-mêmes sont taillés en pièces.
Décrivant les attaques de la nouvelle administration Trump contre la science et le climat, la paléoclimatologue Valérie Masson‑Delmotte dénonce, dans notre émission « À l’air libre », la « remise en cause de l’héritage des Lumières sur le rôle émancipateur des connaissances scientifiques ». On en est là : des pans entiers de ce qui constitue l’assise de notre vie commune depuis des décennies, voire des siècles, sont en train de voler en éclats.
À un moment d’expansion incontrôlée de l’intelligence artificielle, cette rupture anthropologique sur les faits, qui va de pair avec un renversement géopolitique des alliances, nous appelle, en tant que citoyen·nes, à prendre la mesure de la contre‑révolution en cours, et, comme journalistes, à assumer pleinement notre rôle démocratique.
Notre mission d’intérêt public, telle que nous l’envisageons à Mediapart, est de produire une information de qualité, déliée de toutes les pressions d’où qu’elles viennent, pour faire bouger les lignes. Contre la résignation que cherchent à produire les raids contre la liberté d’informer, il est urgent de rappeler que le journalisme, pour peu qu’il ait les moyens de son indépendance, a de l’impact, au service des citoyens et des citoyennes.
En accordant la primauté aux faits recoupés, vérifiés et documentés, en nous appuyant sur la rigueur et l’honnêteté de notre travail journalistique, nous luttons contre les fausses nouvelles et les préjugés.
En plaçant les puissances politiques et économiques face à leurs responsabilités, en révélant leurs abus et leurs mensonges, nous jouons à plein notre rôle de contre-pouvoir qui consiste à demander des comptes à celles et ceux qui tiennent les rênes du pays.
Dans l’histoire de Mediapart, l’impact de nos enquêtes a pu être judiciaire, législatif, financier, politique. Certaines de nos révélations ont abouti à l’ouverture de procédures judiciaires et à des condamnations, à la création de garde-fous démocratiques comme le Parquet national financier ou la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, à des amendements, voire des lois, comme celle qui a interdit le financement des partis politiques français par des banques extra-européennes, à la démission de responsables politiques ou encore à des amendes infligées à des entreprises, ramenant ainsi des centaines de millions d’euros dans les caisses de l’État.
Pour ne prendre qu’un seul exemple en 2024, lors des élections législatives anticipées, nos publications sur les candidat·es du Rassemblement national ont pu dissuader certains électeurs et électrices de leur faire confiance. Les propos racistes, antisémites et homophobes, entre autres, que nous avons dévoilés ont en tout cas montré l’écart entre l’image de respectabilité que Jordan Bardella souhaitait donner de son parti et la réalité.
L’impact tel que nous le définissions se mesure également à l’usage quotidien, social et sociétal, par tout un chacun·e, de notre travail. En donnant du sens à nos informations, c’est‑à‑dire en les contextualisant sans renoncer à la nuance et à la complexité, nos analyses ambitionnent d’aider celles et ceux qui nous lisent à y voir clair et à regarder la catastrophe en face, en leur donnant des repères pour s’y retrouver dans la propagande confusionniste.
En ouvrant des champs d’enquêtes, notamment sur les violences sexistes et sexuelles, nous avons montré à quel point Mediapart était en phase avec des bouleversements profonds de la société et pouvait contribuer à ce que la honte change de camp.
En plaçant sous la lumière des projecteurs des sujets largement ignorés, comme l’islamophobie, les violences sociales ou les droits des enfants, et en portant notre attention éditoriale sur les difficultés rencontrées quotidiennement par nos concitoyen·nes, qu’elles concernent l’inflation, la baisse des salaires réels, la crise du logement ou le délitement des services publics, nous alertons sur les dysfonctionnements structurels de notre organisation économique, et empêchons aussi souvent que possible des mécanismes de se reproduire et de faire de nouvelles victimes.
Nos informations sont des clefs. Elles permettent, à celles et ceux qui le souhaitent, de s’en saisir, pour se mobiliser, pour dénoncer des injustices, pour modifier leurs pratiques, pour choisir des alternatives.
Alors que l’extrême droite mondialisée, par la stratégie assumée du choc et de l’effroi, cherche à anesthésier toute résistance, à transformer la stupeur en accoutumance, puis en acceptation, pire en collaboration, il est de notre responsabilité, avec vous, nos lecteurs et nos lectrices, de nous tenir chaud, d’élargir le cercle de nos soutiens et de passer à l’offensive en marquant de notre empreinte le temps présent. L’indignation, par les temps qui courent, ne suffit plus, il en va de nos conditions d’existence et de celles des générations futures.
À vos côtés, Mediapart a plus que jamais sa place dans ce combat. C’est dans l’adversité que l’utilité politique et sociale du journalisme prend tout son sens. C’est dans des périodes comme celle que nous traversons, de guerres, de crise du capitalisme et de déclin des démocraties, que nous mesurons l’importance de notre fonction au service du public et du bien commun.
-
Carine Fouteau
Présidente et directrice de la publication
Notre utilité
« Face à l’extrême droite, le combat ou l’abîme »
« Macron plonge son camp dans la sidération »,
titre Mediapart en ce soir d’élections européennes le 10 juin 2024, dont le résultat sitôt connu est déjà enjambé politiquement. Le président préfère précipiter le chaos en hâtant une dissolution de l’Assemblée nationale jusque-là prévue pour l’automne, assumant la perspective d’une victoire quasi inéluctable de l’extrême droite, au regard de sa dynamique électorale tout juste constatée dans les urnes européennes.
Dans les locaux de Mediapart s’organise une agora de résistance mêlant militant·es syndicaux, associatifs, artistes et responsables politiques. Tous et toutes conscients de la gravité du moment, et désireux de ne pas être balayés par le bouleversement du paysage politique provoqué par Emmanuel Macron et sa funeste stratégie de marchepied pour l’accession de l’extrême droite au pouvoir. « Le combat ou l’abîme », titre Mediapart, alors que s’ouvre la campagne.
Alors que nous pensions avoir le temps d’ici la prochaine présidentielle pour mettre en ordre de marche nos dispositifs éditoriaux contre l’extrême droite, la dissolution oblige notre rédaction à se jeter collectivement corps et âme dans la documentation de ce que représenterait l’arrivée du Rassemblement national (RN) au pouvoir. Le travail est institutionnel, s’envisage à travers divers corps de métier, mêle l’expression de ressentis comme des expertises juridiques… Il avait déjà en partie été fait en 2022, mais il faut le remettre à jour à l’aune d’une accession à Matignon dans un cadre de cohabitation.
D’autres se penchent sur le pedigree des candidat·es investi·es à la hâte par le parti d’extrême droite, pour mieux dévoiler les faux-semblants de sa « dédiabolisation ». Alors que Jordan Bardella ne reconnaît au début que « quatre ou cinq brebis galeuses » parmi les aspirant·es député·es, Mediapart en débusque au moins cent six aux propos haineux et complotistes, à l’instar de nos confrères de Streetpress ou Libération.
De Nanterre au Puy-en-Velay, en passant par Arras, Limoges, Montpellier, la Bretagne, l’Alsace ou le Pays basque… En un mois et une cinquantaine de reportages, notre rédaction a saisi l’inattendu politique.
Dans ce contexte, nous avons décidé, exceptionnellement, de permettre la lecture en accès libre d’un dossier de 31 articles qui racontent les menaces que l’extrême droite fait peser sur la France et sur ses habitantes et habitants.
Dans le Club de Mediapart, l’espace de libre expression de nos abonné·es, la société civile s’exprime également. De nombreuses tribunes apparaissent, des streamers aux urbanistes et architectes, en passant par les scientifiques ou les soignant·es. De nombreux textes ont également vu le jour, montrant les mobilisations collectives sur le terrain, et des témoignages individuels sur le péril de l’extrême droite en tant que minorités.
Durant cette campagne législative en forme de Blitzkrieg, le studio de Mediapart tourne également à plein, réunit des intellectuel·les de tous horizons pour alerter sur le danger de l’extrême droite, puis renouvelle l’expérience avec de jeunes artistes, activistes et streamers. Il accueille aussi une soirée d’interpellations et d’échanges entre figures militantes de la société mobilisée et responsables politiques du Nouveau Front populaire.
Rapidement, l’envie de voir plus grand et de porter nos émissions hors les murs se fait ressentir. Dans le sillage du Fonds pour une presse libre, et aux côtés de nombreux médias, associations, syndicats, personnalités et musicien·nes, la place de la République est envahie. D’abord le 27 juin avant le premier tour, puis le 3 juillet, à trois jours du second tour, dans une ambiance de folle résistance.
Comment Mediapart a rapporté 470 millions d’euros à l’État
Six ans après les révélations de Mediapart, l’Autorité de la concurrence a infligé, en novembre 2024, 470 millions d’euros d’amende à quatre entreprises du secteur du matériel et de la distribution électrique, Schneider Electric, Legrand, Rexel et Sonepar.
Mediapart avait révélé l’existence de ce cartel en avril 2018, dans un article titré « L’entente secrète des géants de l’électricité », et rédigé après une enquête longue, pointue, technique, qui n’avait certes pas rencontré un large succès d’audience, mais qui avait attiré l’attention du gendarme de la concurrence. Celui-ci avait déclenché une enquête dans la foulée.
470 millions d’euros, c’est colossal. C’est plus que l’ensemble des sanctions infligées par l’Autorité en 2022 et 2023. Mais c’est aussi, à titre d’exemple, l’équivalent de la somme qui manquait au budget de la justice pour 2025, en raison des coupes budgétaires, et qui a provoqué un bras de fer au sein du gouvernement.
Dans ses investigations sur les distributeurs de matériel électrique Mediapart avait révélé, outre l’entente illicite, des éléments qui ont aidé la justice à investiguer sur de possibles faits de corruption et de fraude fiscale.
Sur ce volet, l’enquête est toujours en cours. Une condamnation entraînerait en toute logique de nouvelles rentrées d’argent dans les caisses de l’État. Lequel comprendra peut-être un jour qu’en réinvestissant une partie de cet argent dans la lutte contre la corruption et la fraude fiscale, il réaliserait un investissement particulièrement lucratif.
Nous n’avons jamais essayé de calculer tout ce que notre travail a rapporté à la puissance publique depuis dix-sept ans, car cela serait imprécis, et peut-être un peu vaniteux, mais voici quelques exemples.
- L’enquête sur la fraude à l’arbitrage dans l’affaire Tapie ? 270 millions qui reviennent dans les poches de l’État.
- La fraude fiscale dans l’affaire Bettencourt ? Plus de 100 millions.
- Celle de Ziad Takieddine ? 20 millions.
- Prenez Thierry Gaubert, Patrick Balkany (sur lequel Mediapart n’est toutefois pas le seul à avoir enquêté) ou encore Jérôme Cahuzac, et vous pouvez ajouter quelques millions supplémentaires.
- Le démarchage illégal et les fraudes d’UBS (sur lesquelles Mediapart a enquêté après les révélations du journaliste Antoine Peillon) ? 1,8 milliard d’euros.
Quant au groupe Kering, il a dû, après nos enquêtes, s’acquitter de plus de 200 millions d’euros pour solder l’évasion fiscale de ses maisons Yves Saint Laurent et Balenciaga. En Italie, sur la même affaire qui concerne la filiale Gucci, le redressement s’est élevé à 1,25 milliard d’euros.
Car il n’y a pas que le Trésor français ! Nos enquêtes européennes, menées avec le réseau de médias d’investigation EIC, renflouent les caisses d’autres pays. Les Football Leaks ont par exemple été l’occasion pour l’Espagne de reprendre près de 19 millions d’euros à Cristiano Ronaldo, et quelques autres millions à des joueurs du Real Madrid.
Sarkozy-Kadhafi : un procès pour l’histoire
Quand Mediapart a révélé l’affaire libyenne en 2011, personne n’y croyait. Quatorze ans et près de deux cents articles plus tard, certains doutent encore, tant les faits défient le sens commun.
« Si c’était une série, on dirait que le scénario est invraisemblable », plaide déjà Nicolas Sarkozy. Pourtant, après une enquête minutieuse, la justice a renvoyé l’ancien président, trois de ses anciens ministres et neuf autres prévenus devant le tribunal. Le procès, historique, suivi par des médias du monde entier, se tient du 6 janvier au 10 avril 2025.
Mediapart propose à ses lecteurs et lectrices des comptes rendus, écrits et vidéos, leur permettant de suivre au jour le jour le procès avec les journalistes qui ont révélé et chroniqué l’affaire. Ainsi que les repères chronologiques, anecdotes, phrases cultes, documents clés et biographies des protagonistes de cette histoire : peut-être la plus folle et la plus grave qu’ait connue la Ve République.
Autour de cette affaire, nous rêvions aussi d’un film. Pour percer le mur de l’indifférence. Pour partir à la rencontre des spectateurs et spectatrices. Pour offrir un contre-récit au bulldozer médiatique dominant. Mais nous n’avions pas les moyens de fabriquer un tel documentaire et, cela va sans dire, nous ne comptions ni sur le soutien de Canal+, ni sur le conseil régional d’Île-de-France de Valérie Pécresse, ni sur aucune subvention étatique. Ce film est pourtant sorti au cinéma le 8 janvier 2025. Son titre : Personne n’y comprend rien.
Le financement ? Ce sont finalement 10 000 généreux donateurs et donatrices qui l’ont apporté, à hauteur de 500 000 euros, soit le financement participatif le plus important de l’histoire du cinéma. Dans les salles, bien souvent, la première ovation du film, émouvante, est d’ailleurs réservée à ces donateurs et donatrices dont le nom apparaît à la fin du générique, et sans qui rien n’aurait été possible. Une autre devrait être réservée aux abonné·es de Mediapart. Sans qui ces quatorze années d’enquête n’auraient pas non plus été possibles.
De Brest, de Toulouse, de Nantes ou d’ailleurs, les journalistes envoyé·es aux projections-débats organisées depuis la sortie du film Personne n’y comprend rien n’en reviennent pas : partout des files d’attente, des spectateurs refusés, des salles supplémentaires ouvertes en catastrophe par des gérants de salle ultra-motivés. Après neuf semaines d’exploitation, le film a fait près de 150 000 entrées en salles !
Et partout une ferveur immense. Des remerciements. Des applaudissements. Des spectateurs et des spectatrices qui ont parfois parcouru plus de 100 kilomètres pour venir voir le film en salle et qui débattent pendant une heure et demie, deux heures, deux heures et demie. Insensé.
Cela paraît immodeste de rapporter cela. Ça l’est. Mais c’est un fait, et cela fait chaud au cœur. Surtout après tant d’années à crier dans le désert autour d’une affaire qui nous paraît si importante et qui passe enfin en procès.
Stanislas et l’affaire Oudéa-Castera
Si la ministre de l’éducation nationale, alors fraîchement nommée, a mis ses enfants dans le privé, c’est à cause « des paquets d’heures pas sérieusement remplacées », lâche-t-elle lors de son tout premier déplacement officiel, au micro de Mediapart. Amélie Oudéa-Castéra est tout juste nommée qu’elle suscite déjà l’indignation de tout le corps enseignant. En plus de bouder le public, elle n’a pas choisi n’importe quel établissement : ses trois enfants sont scolarisés dans le très catholique collège-lycée Stanislas.
Dans une enquête publiée à l’été 2022, Mediapart détaillait la vision sexiste, homophobe et autoritaire de l’enseignement qui y était prodigué. Depuis, les ministres de l’éducation nationale sont tétanisés. Pap Ndiaye a tardé à demander un rapport d’inspection, Gabriel Attal n’a pas voulu en communiquer les conclusions.
Les révélations autour de la ministre Amélie Oudéa-Castéra ont également fait office de sérum de vérité en ce qui concerne le jeu inégal que mènent l’école publique et l’école privée sous contrat en France : un enseignement privé qui, perfusé d’argent public, pratique une ségrégation sociale systémique pour garantir l’entre-soi des élites. Jusqu’à affaiblir l’école républicaine.
« L’affaire marque la fin d’un cycle et d’une omerta politique qui a duré quarante ans », prophétisait le député insoumis Paul Vannier dans nos colonnes.
De révélation en révélation, la situation est vite devenue intenable, et Amélie Oudéa-Castéra est retournée au seul ministère des sports, vingt-huit jours après sa nomination rue de Grenelle.
#MeToo : des enquêtes journalistiques indispensables
Mediapart est souvent la cible d’attaques à propos de ses enquêtes sur les violences sexistes et sexuelles : nous serions le bras armé, voire le théâtre, d’un supposé « tribunal médiatique » où des foules de victimes viendraient cracher leur « haine des hommes » et bafouer la « présomption d’innocence ». Ce discours reçoit régulièrement un accueil complaisant sur les plateaux télé et en librairies où prospèrent des essais hostiles à #MeToo.
L’année 2024 a apporté un démenti cinglant à ces critiques. Plusieurs enquêtes de Mediapart ont conduit à la tenue d’un procès et même à la condamnation de certaines personnalités. Nous ne sommes pas des auxiliaires de justice, et nous ne sommes pas là pour dire qui doit être condamné – encore moins à quelle peine. Cela démontre cependant le sérieux de notre travail.
Le premier exemple est le plus emblématique : la condamnation du réalisateur Christophe Ruggia, le 3 février 2025, à quatre ans d’emprisonnement, dont deux ans ferme sous bracelet électronique, pour violences sexuelles sur mineure de 15 ans. Un jugement dont il a fait appel.
« La parole des victimes est méprisée » ; « Les monstres, ça n’existe pas » : le 4 novembre 2019, après une longue enquête journalistique menée par Marine Turchi, Adèle Haenel prenait la parole sur Mediapart pour faire état de violences sexuelles subies entre ses 12 ans et ses 15 ans. La force de ses mots sur la justice ou le silence des familles face aux violences sexuelles a provoqué un séisme dans le cinéma et dans toute la société.
Autre exemple : trois anciennes compagnes de Stéphane Plaza, star de la télé et agent immobilier, ont témoigné dans Mediapart, grâce au travail de Sarah Brethes, avoir subi des violences physiques et psychologiques. Deux d’entre elles ont ensuite porté plainte et une enquête a été ouverte par le parquet de Paris en octobre 2023. Un an et demi plus tard, l’animateur de M6 a été jugé coupable de violences conjugales sur une de ses ex-compagnes, et relaxé des poursuites pour violences psychologiques sur une seconde plaignante. Une décision dont il va faire appel.
Dans la foulée, le groupe M6 a annoncé la déprogrammation de ses émissions. Une décision que la chaîne avait catégoriquement refusé de prendre jusque-là. Une partie des agents immobiliers du réseau Plaza ont également décidé de claquer la porte.
Enfin, en mars 2025, doit avoir lieu le premier procès visant Gérard Depardieu – dans une affaire révélée par Mediapart là encore. En 2024, deux femmes ayant travaillé sur le tournage du film Les Volets verts ont en effet accusé le comédien d’agressions sexuelles. Celui-ci dément tout comportement pénalement répréhensible.
Depuis nos premières révélations sur l’affaire Depardieu en 2018, plus de vingt femmes ont accusé l’acteur de violences sexuelles et sexistes, dans Mediapart ou auprès de la justice.
Mais n’en déplaise à nos détracteurs et détractrices, l’utilité de notre travail ne se limite pas à son impact judiciaire : nous continuons à révéler des faits, hors de toute procédure en justice, dans le cadre de notre mission d’intérêt général. Ce fut encore le cas récemment avec nos révélations sur l’acteur et réalisateur Franck Gastambide, le témoignage de la chanteuse Flore Benguigui à propos du sexisme dans l’industrie musicale ou sur certains imams influenceurs.
Les droits des enfants : un nouveau champ d’enquête
« Les infanticides sont un fléau, un phénomène massif : on estime qu’un enfant meurt ainsi tous les cinq jours en France. » Ainsi parle, dans un reportage poignant de Mathilde Mathieu, une militante de l’association Protéger l’enfant. Mais qui le sait ? Quand cela fait-il la une des journaux ? Il n’y a même pas de ministre délégué aux droits des enfants.
Depuis un peu plus d’un an, notre journaliste se consacre entièrement à ce sujet avec l’objectif de rendre visible ce qui l’est trop peu, et de donner du sens à une réalité trop longtemps traitée sous l’angle du fait divers sordide.
Mediapart a ainsi décidé de revenir sur les quarante-six cas de morts violentes d’enfants recensés en 2024 dans un cadre familial. En leur donnant un prénom, un visage, une histoire. Parce que ces morts comptent et devraient nous interroger bien davantage.
L’affaire des violences à Notre-Dame-de-Bétharram, le procès du chirurgien Joël Le Scouarnec, qualifié de plus grande affaire de pédocriminalité en France, mais aussi les maltraitances en crèche ou les violences éducatives : les enfants, leurs droits et leur protection sont les parents pauvres des politiques publiques. À nous de les mettre dans la lumière pour que la société prenne conscience de l’ampleur de la tâche.
En écho, dans le Club, l’affaire Bétharram a impulsé un ensemble de textes, dont des témoignages sur les violences dans les établissements privés.
Écologie : enrayer la catastrophe
Une décision historique et une faillite retentissante dans la même journée. En annulant l’autorisation de l’autoroute A69 le 27 février 2025, le tribunal administratif de Toulouse a réalisé un coup double : c’est la première fois que la justice annule un projet d’autoroute pour des raisons environnementales et la première fois qu’elle arrête un chantier de si grande ampleur. Depuis 2023, Mediapart a largement couvert la lutte autour de ce projet qui concentre tous les éléments qui guident l’engagement écologique de notre journal.
Les travaux scientifiques sont sans appel : le changement climatique en cours a déjà conduit à une hausse de température de plus de 1,2 °C en moyenne sur la planète par rapport à l’ère préindustrielle ; et depuis 1900, l’abondance des espèces animales et végétales dans la plupart des grands habitats terrestres a diminué d’au moins 20 %. Ces bouleversements planétaires, dus aux activités humaines et à l’urbanisation galopante, ont entraîné des changements irréversibles. Mais il est encore possible de limiter l’étendue du désastre. Pour l’heure, dans une écrasante majorité de pays, les pouvoirs politiques et économiques n’en prennent pas le chemin.
C’est fort de ce constat que Mediapart travaille, depuis sa création en 2008, et en toute indépendance, sur les questions écologiques. Depuis, l’état de la planète s’est fortement dégradé : la hausse des températures et la détérioration du vivant sont allées plus vite que les scénarios scientifiques, les événements climatiques extrêmes se multiplient, et chaque été apporte son lot de nouveaux désastres, entre sécheresse record et apparition d’incendies dans des régions jusque-là épargnées.
Ces catastrophes sont la partie la plus spectaculaire, la plus saisissante, et donc la plus médiatisée des bouleversements en cours. Mais celles-ci sont loin, très loin de se limiter à des flammes incontrôlables et à un mercure anormalement élevé.
Par son travail quotidien de décryptage de l’actualité, ses investigations, ses reportages sur le terrain et ses espaces de débats, Mediapart publie sur les thématiques écologiques quelle que soit l’actualité dominante du moment et débusque des scandales dont personne ne parle. Deux fils rouges nous guident : dénouer les mécanismes économiques et sociaux à l’œuvre dans cette prédation généralisée, esquisser des pistes pour l’enrayer. Les désastres écologiques et climatiques ne sont pas une fatalité : il y a des responsables, il y a des victimes, et nos sociétés pourraient fonctionner autrement.
Enquêtes sur TotalEnergies, le scandale des eaux en bouteille de Nestlé, les mensonges sur la dépollution de la Seine pendant les Jeux olympiques, les impacts désastreux des mégabassines sur la ressource en eau, le désespoir des agents de l’Office français de biodiversité lâchés par leurs autorités de tutelle, l’opacité sans fond du système nucléaire… Fruit d’un sillon creusé depuis quatorze ans, nourri par de multiples réflexions collectives depuis, enrichi par la croissance de notre équipe, notre traitement journalistique des questions écologiques s’est peu à peu aiguisé et nous a amenés à faire entendre une musique particulière dans un paysage médiatique resté longtemps ignorant de ces sujets.
Notre couverture des questions écologiques est aussi fortement liée à notre communauté de lectrices et lecteurs : l’espace de débat constitué par le Club de Mediapart s’enrichit continuellement de contributions sur les thématiques écologiques, tandis que nous recevons de plus en plus souvent des alertes donnant lieu à des enquêtes.
Se mobiliser, être dans l’action – plutôt que dans l’abattement et la dépolitisation : telle est la voie journalistique que nous avons empruntée pour faire face au désastre.
Un journal qui regarde et décrypte le monde : un regard singulier
Le monde est à un tournant : l’extrême droite menace ou prend le pouvoir, les vieilles alliances sont à terre sans que de nouvelles émergent, deux guerres font des ravages tout près de nous, en Ukraine et au Proche-Orient.
Un journal ne peut pas détourner le regard, il doit être au cœur de cette actualité. Pour la comprendre, lui donner du sens et documenter aussi les violences ou les manquements.
La guerre destructrice menée par Israël à Gaza, après les massacres commis par le Hamas le 7 octobre 2023, l’a montré avec une brûlante actualité : depuis ce jour, nous n’avons cessé de raconter et de contextualiser, d’aller sur le terrain et d’interroger les spécialistes de la région. De rappeler le droit international, dans un contexte colonial, et le respect absolu de la vie des civil·es. De condamner l’antisémitisme, d’où qu’il vienne, et la dénonciation de la déshumanisation des vies palestiniennes et arabes en général dans le traitement politique et médiatique français.
Face au silence et à la passivité tragique des autorités françaises, nous ne pouvions rester silencieux : nous n’avons jamais cessé de couvrir cette guerre conduite par Benyamin Nétanyahou et son gouvernement d’extrême droite, même quand la récurrence des massacres semblait laisser de marbre la plupart des médias. Nous avons rappelé la position du journal – à commencer par le respect du droit international et la condamnation sans réserve du crime de génocide.
Nous avons aussi souligné l’absurdité à défendre le droit des Ukrainien·nes à défendre leur pays et son intégrité territoriale, en oubliant celui des Palestinien·nes, de Gaza ou de Cisjordanie, celui des Libanais·es du sud du pays ou des Syrien·nes du Golan. Cette hypocrisie largement partagée dans les pays dits occidentaux est une catastrophe pour notre humanité commune.
L’utilité d’un journal c’est aussi, parfois, de sonner l’alerte.
Médias : défendre l’exigence d’information contre le règne de l’opinion
« Faire primer l’opinion sur l’information » ou encore « tord[re] les faits pour coller à une ligne ultra-réac »
Voilà ce que des journalistes de CNews disent des demandes de leur hiérarchie dans une enquête de Mediapart sur le bras armé de Bolloré au service de ses obsessions identitaires et sécuritaires. Exemple : l’affaire du meurtre de Thomas Perotto à Crépol, où les journalistes en plateau n’ont pas hésité à balancer de fausses informations en toute connaissance de cause.
En février 2024, une décision historique du Conseil d’État vient confirmer ce que Mediapart ne cesse de documenter : saisie par Reporters sans frontières, la juridiction a demandé au régulateur de l’audiovisuel de renforcer son contrôle sur CNews, estimant que la chaîne ne pouvait plus « être considérée comme une chaîne d’information ».
Autre milliardaire, même entrave au travail des journalistes, avec Bernard Arnault, patron du groupe LVMH et propriétaire du groupe Les Échos-Le Parisien. Mediapart a révélé l’envers de l’empire du luxe et la prédation du milliardaire sur plus de deux cents adresses de la capitale française. En retour, le patron de presse Bernard Arnault a donné ordre de mettre Mediapart sur une liste noire de plusieurs médias auxquels il est interdit de répondre et met en garde celles et ceux qui dérogeraient à la règle.
Un impact qui, au-delà d’être désagréable et préjudiciable au droit à l’information, démontre qu’enquêter sur les médias détenus par les milliardaires est plus que jamais nécessaire pour préserver le droit fondamental des citoyen·nes à l’information.
Notre contre-proposition éditoriale face à l’agenda médiatique dominant
Des jeunes Françaises, pas encore dans le monde du travail et qui anticipent déjà que leur voile sera un problème.
Un lycée musulman, à Lyon, qui a perdu son contrat avec l’État et qui se bat contre la machine administrative et ses préjugés ; une salle de prière d’une association franco-turque incendiée, à la veille du ramadan, dans le Loiret : Mediapart documente depuis de nombreuses années l’islamophobie, à rebours de nombreux médias qui la minimisent, sinon l’alimentent.
Six mois après les révoltes en Nouvelle-Calédonie, provoquées par la révision constitutionnelle d’Emmanuel Macron, Mediapart est retourné sur les lieux de la mobilisation indépendantiste pour raconter, en donnant la parole aux premiers et premières concernées, cette décolonisation empêchée. Une série d’articles au cœur de la promesse éditoriale de Mediapart : faire entendre celles et ceux dont la parole est confisquée.
Qu’il s’agisse d’islamophobie ou de Nouvelle-Calédonie, mais aussi des violences policières, des discriminations au sens large ou du nucléaire, Mediapart investit des champs éditoriaux trop souvent ignorés par d’autres médias et traités uniquement au travers des déclarations incendiaires du personnel politique.
L’impact de ces sujets ne se mesure pas nécessairement à l’aune d’une décision judiciaire ou d’un changement législatif. Les traiter est (d’autant plus) d’utilité publique. C’est un choix éditorial dont nous sommes fières et fiers et qui permet, patiemment, article après article, de nous distinguer en proposant une contre-programmation à l’agenda politique et médiatique dominant.
Nos autres impacts
Onze ans après notre premier article sur l’affaire dite des assistants parlementaires du FN au Parlement européen, le parquet réclame l’inéligibilité avec exécution provisoire pour l’ensemble des prévenu·es, dont Marine Le Pen.
L’ex-ministre de la santé Agnès Firmin Le Bodo est condamnée pour ses liens avec l’industrie pharmaceutique.
OnePoint : le parquet de Paris a ouvert une enquête pour « usurpation de titre ».
La justice ouvre une enquête pour détournement contre la députée RN Christine Engrand.
La présidente du Haut Conseil à l’égalité est limogée deux mois après une enquête de Mediapart.
Une enquête pour « génocide » est ouverte contre un ancien gendarme rwandais réfugié en France.
Marché de l’eau : cinq ans après nos révélations, l’ancien ministre Olivier Dussopt est condamné en appel.
Pédocriminalité, guets-apens homophobes… Le site Coco a enfin été fermé par la justice.
Affaire Legay : l’histoire du document qui a fait condamner le commissaire de police.
Quelques jours après nos révélations, le patron du groupe de presse Ebra démissionne.
Cinq ans après nos révélations, Frank Supplisson, ex-conseiller de Sarkozy, est lourdement condamné dans un scandale industriel.
Aidez nous à continuer à avoir toujours plus d’impact

11 questions pour découvrir notre tout premier rapport d'impact sur l’année 2024
Autres moments marquants
Évènements
La grande Révolte, des films et des luttes
Le festival cinéma de Mediapart et la Grande distribution
Le village des médias indépendants à la Fête de l’Humanité
Une première pour faire vivre la presse indépendante
Une journée pour décortiquer l’entreprise de Bernard Arnault et sa place en France
Nouveaux formats
Humour à Mediapart
Nos positions d’entreprise
Changement de présidence
Mars 2024
Des faits et du sens : notre exigence dans un monde disjoncté
Médias
Droits voisins
Avril 2024
Mediapart lance la bataille de la transparence contre Google
Médias
Une responsable éditoriale aux questions raciales
Septembre 2024
« Responsable éditoriale aux questions raciales », pour quoi faire ?
Médias
Mediapart quitte X
Décembre 2024
Contre la désinformation, Mediapart quitte X
Médias
Charte IA
Janvier 2025
Intelligence artificielle : Mediapart se dote d’une charte
Médias
Notre indépendance
Comme chaque année en mars, Mediapart publie tous ses chiffres, comptes et résultats, s’obligeant à une transparence unique dans la presse. Pourquoi ?
- Parce que le modèle économique de Mediapart dépend à 99 % de ses abonné·es, qui financent ainsi le journalisme d’impact décrit dans ce rapport ; nous leur devons des comptes et nous voulons leur expliquer comment nous dépensons, réinvestissons et mettons en réserve l’argent collecté via leurs abonnements.
- Parce que la transparence est une vertu cardinale pour nous : nous l’exigeons des puissances politiques, économiques, publiques qui nous gouvernent ; nous la pensons plus nécessaire que jamais pour protéger la démocratie au moment où les fake news et la désinformation prospèrent sur tous les canaux d’information.
- Parce que, enfin, nous voulons montrer qu’un journalisme indépendant et rentable, financé par ses lecteurs et lectrices et exigeant dans ses principes, est non seulement possible mais nécessaire. Alors que la démocratie subit, partout dans le monde, les coups de boutoir d’idéologies illibérales et conservatrices, nous voulons témoigner, à travers l’exemple de Mediapart, de l’utilité de choix radicalement démocratiques et indépendants dans le travail journalistique et les modèles économiques qui l’accompagnent.
L’entreprise
99 % des revenus proviennent des abonnements
Dès sa création, Mediapart a fait le pari d’un modèle économique à 100 % indépendant, financé uniquement par l’abonnement.
À la fin de l’année 2024, le portefeuille d’abonné·es atteint le record de 233 277, générant un chiffre d’affaires annuel de 24,9 millions d’euros (+ 11,4 % par rapport à 2023).
Mediapart réussit ainsi à autofinancer l’ensemble de son activité et de ses développements, en mobilisant perpétuellement ses moyens pour le droit de savoir de tous et toutes.
0 publicité, aide à la presse, contrat commercial avec les géants de la tech, emprunt bancaire
La radicalité du modèle de journalisme défendu par Mediapart l’a amené, au fil des années, à n’accepter aucune autre forme de revenu que l’abonnement. Ainsi, contrairement à la grande majorité des autres médias d’information, Mediapart ne diffuse pas de publicité, ne demande pas d’aides à la presse (des millions d’euros d’argent public sont chaque année reversés à des titres qui en font la demande), et n’a jamais voulu passer de contrat commercial avec les Big Tech. Par ailleurs, Mediapart n’a aucun emprunt bancaire et autofinance l’ensemble de ses projets.
Mediapart garantit ainsi sa totale indépendance éditoriale, en n’ayant de comptes à rendre qu’à ses lecteurs et lectrices.
1 actionnaire : le Fonds pour une presse libre, fonds de dotation à but non lucratif
À rebours d’un monde médiatique français ultraconcentré dans les mains de quelques milliardaires, Mediapart a fait le choix de sanctuariser son capital au sein d’un fonds de dotation, le rendant ainsi inviolable et inachetable. L’indépendance éditoriale est en outre soigneusement protégée par les statuts du Fonds pour une presse libre, dont l’objet principal réside dans le soutien financier à l’écosystème de la presse indépendante.
Mediapart s’est ainsi rendu durablement imperméable à toute prise de contrôle extérieure qui viserait à affaiblir ou dénaturer son travail ou à détourner le journal de son projet éditorial.
65 % des dépenses consacrées aux salaires
Mediapart s’efforce d’aligner perpétuellement les valeurs que le journal prône publiquement aux conditions de travail de ses collaborateurs et collaboratrices.
En 2024, on peut notamment relever :
- 65 % du total des dépenses du journal consacré aux salaires (13 millions d’euros) ;
- un ratio de 1 à 3 entre le plus bas salaire et le plus haut salaire de l’entreprise ;
- une participation des salarié·es aux résultats représentant un total de 1 million d’euros sur 2024 ;
- la mise en place du congé menstruel et hormonal ;
- la rédaction d’une charte sociale sur les valeurs de la rémunération et des négociations pour la mise en place d’une nouvelle politique salariale.
14 ans de rentabilité financière
Alors que les médias privés accumulent en France des déficits parfois colossaux, se rendant ainsi fragiles aux prises de contrôle extérieures et rognant perpétuellement sur les conditions de travail, Mediapart s’enorgueillit d’une rentabilité financière constante et solide depuis quatorze ans.
Avec un chiffre d’affaires de 24,9 millions d’euros, en hausse de 11,4 % par rapport à 2023, le journal affiche cette année un record de recettes.
La gestion des dépenses, rigoureuse mais dynamique, s’assure quant à elle que les trois piliers de notre croissance sont alimentés : la politique sociale de l’entreprise, car Mediapart ne crée de la valeur que grâce à ses collaborateurs et collaboratrices ; le développement et l’innovation, car il faut sans cesse se réinventer pour durer ; la constitution de réserves financières, pour affronter l’avenir.
Le maintien d’une rentabilité importante est pour Mediapart le seul moyen d’assurer à long terme son indépendance et donc de perpétuer son travail au service du droit de savoir.
420 tCO2e
Depuis sa création en 2008, Mediapart a pris le parti d’être 100 % en ligne : le journal n’est pas édité sur papier. Ce choix nous permet d’avoir une empreinte inférieure aux médias imprimés, mais elle n’est pas nulle pour autant. Nous avons décidé d’y voir plus clair, afin de nous engager sur une trajectoire de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre, directes et indirectes. C’est ainsi que nous avons réalisé, fin 2023, le premier bilan carbone de l’histoire de Mediapart.
Notre audience
26,6 millions de pages vues par mois
En 2024, l’audience sur notre site et notre application mobile a connu une hausse de 26 % :
- 11 millions de visites par mois ;
- 26 millions de pages vues par mois ;
- 4,4 millions de visiteurs uniques.
1,5 millions d’écoutes de podcasts
Résumés sonores, articles lus, podcasts… Mediapart s’écoute aussi sur notre site et notre application, ainsi que sur les plateformes d’écoute.
30 millions de vidéos vues
Émission d’actualité « À l’air libre », enquêtes en vidéo, émissions spéciales, grands entretiens, reportages, documentaires au cinéma… Mediapart offre de nombreux contenus vidéo à ses abonnés, mais aussi en accès libre, diffusés sur Mediapart et nos réseaux sociaux.
Alors que la production de films documentaires est foisonnante, la question de leur visibilité sur les écrans est plus difficile. C’est pourquoi Mediapart diffuse chaque samedi un film documentaire, disponible pour nos abonné·es durant quatre semaines. Au cœur du journal, c’est un espace ouvert à d’autres narrations, d’autres temporalités, d’autres images du monde.
435 000 personnes inscrites aux newsletters
Mediapart propose une large sélection de newsletters relayant les principaux titres de l’actualité. Certaines contiennent des contenus exclusifs, offrant une meilleure compréhension des coulisses de nos révélations, ou partageant le point de vue de certains de nos journalistes. Choisissez celles qui correspondent à vos sujets favoris et à la périodicité idéale !
Nos enquêtes emblématiques
-
Affaire Tapie : les millions publics d’une justice privée
Avec le décès de Bernard Tapie, les poursuites pénales à son encontre s’éteignent, mais pas celles visant les autres prévenus, qui ont été condamnés par la cour d’appel. Et plusieurs ramifications de cette affaire, dont celle qui concerne Eric Woerth, mis en examen dans le volet fiscal, restent pendantes.
-
L’empire caché de Vincent Bolloré
On dit Vincent Bolloré à l’affût de tout, des médias, des télécoms, des coups financiers. Pourtant, son groupe ne semble pas de taille à mener de telles batailles. Il pèse à peine six milliards d’euros de chiffre d’affaires. D’où tire-t-il alors cette puissance ?
-
Bettencourt : les secrets volés de la république
Des aigrefins ont dépouillé la femme la plus riche de France. Derrière le conflit familial, une affaire politico-financière. Depuis la décision du 4 juillet 2013, Mediapart n’a plus le droit de diffuser les enregistrements du majordome de Liliane Bettencourt. Au total, 70 articles se référant et citant ces enregistrements ont été censurés depuis cette date, à la demande de Patrice de Maistre.
-
L’affaire des quotas dans le football français
Moins de noirs et moins d’arabes sur les terrains de foot ! Plusieurs dirigeants de la Direction technique nationale de la Fédération française de football, dont le sélectionneur des Bleus, Laurent Blanc, ont approuvé dans le plus grand secret, fin 2010, le principe de quotas discriminatoires officieux dans les centres de formation et les écoles de foot du pays. Objectif: limiter le nombre de joueurs français de type africains et nord-africains.
-
Sarkozy-Kadhafi : le président et le dictateur
L’une des affaires les plus explosives de la République. À ce jour, sont notamment mis en examen : Nicolas Sarkozy, Claude Guéant, Brie Hortefeux, Éric Woerth, Thierry Gaubert, ainsi que les intermédiaires Ziad Takieddine et Alexandre Djouhri.
-
Le compte Cahuzac
L’affaire du compte en Suisse, ouvert à ’UBS-Genève puis transféré à Singapour et dissimulé par l’ancien ministre du budget. De notre première enquête à la commission d’enquête parlementaire et au jugement du 8 décembre 2016.
-
Les privilèges cachés des parlementaires
Depuis son lancement, Mediapart a chroniqué les abus et privilèges des sénateurs : indemnités achées, bonus de retraite, affaire Pastor, clientélisme, soupçons de détournement de fonds…
-
L’argent russe de Marine Le Pen
Le Rassemblement national a bénéficié de deux prêts russes en 2014 (9 millions pour le parti, 2 millions pour le microparti de Jean-Marie Le Pen). Ces financements se sont accompagnés d’un alignement du parti sur les positions du Kremlin. En 2017, Marine Le Pen a été reçue officiellement par Vladimir Poutine. Des interrogations demeurent sur d’autres prêts.
-
Denis Baupin, deux ans avant #metoo
Des femmes ont dénoncé ses agressions et harcèlements sexuels. Le député a perdu le procès qu’il nous avait intenté. Nos enquêtes, articles et analyses sur cette affaire et le harcèlement sexuel en politique.
-
Les services secrets de l’état islamique
L’État islamique a, lui aussi, ses services secrets. Une enquête au long cours de Mediapart révèle les méthodes de contre-espionnage utilisées par les djihadistes. Elles n’ont rien à envier aux pratiques de la Guerre Froide Et expliquent comment les attentats qui ensanglantent l’Europe ont été rendus possibles.
-
Benalla, Kohler, Mckinsey : les hommes du président
L’affaire Alexandre Benalla, dans laquelle la privatisation de la sécurité présidentielle, avec ses dérives barbouzardes, dévoile la part d’ombre du monarchisme macronien.
-
Le symbole Adèle Haenel
L’actrice Adèle Haenel accuse le réalisateur Christophe Ruggia d’« attouchements » et de « harcèlement sexuel » lorsqu’elle était âgée de 12 à 15 ans. Son récit est conforté par de nombreux documents et témoignages. Mediapart retrace son long cheminement, de la « prise de parole impossible » au « silence devenu insupportable ». Le cinéaste conteste « catégoriquement » les faits.
-
Les masques « ce n’est pas nécessaire ». Le récit d’un mensonge d’état
Pénurie cachée, consignes sanitaires fantaisistes, propositions d’importations négligées, stocks toujours insuffisants, entreprises privilégiées : basée sur de nombreux témoignages et documents confidentiels, une enquête de Mediapart révèle la gestion chaotique au sommet de l’État, entre janvier et aujourd’hui, sur la question cruciale des masques. Et les mensonges qui l’ont accompagnée. Les soignants, eux, sont contaminés par centaines.
-
Policiers brûlés à viry-chatillon : la fabrique de faux coupable
Alors que le verdict prononcé en appel par la cour d’assises de Paris, le 18 avril, a suscité des réactions outragées, Mediapart révèle qu’en garde à vue, les policiers ont tronqué des pans entiers des propos de prévenus et ont fait pression pour que soient mis en cause des jeunes du quartier.
-
Total
TotalEnergies sait que ses activités sont nocives pour le climat depuis 1971. Pourtant, le géant pétrolier continue d’émettre autant de gaz à effet de serre que l’ensemble des Français·es. En pleine crise énergétique, TotalEnergies a annoncé début 2022 un bénéfice record de 14 milliards d’euros.
-
L’affaire Stéphane Plaza
Trois anciennes compagnes de l’agent immobilier popularisé par M6 ont témoigné dans Mediapart avoir subi des violences physiques et morales de sa part. Deux d’entre elles ont porté plainte et une enquête a été ouverte par le parquet de Paris en octobre 2023. Stéphane Plaza a été condamné à douze mois de prison avec sursis le 28 février 2025.
-
Stanislas et l’affaire Oudéa‑Castera
En juin 2022, une enquête de Mediapart révèle l’univers sexiste, homophobe et autoritaire de Stanislas, établissement privé catholique parisien élitiste. Depuis, les ministres de l’éducation nationale sont tétanisés. Pap Ndiaye a tardé à demander un rapport d’inspection, Gabriel Attal n’a pas voulu en communiquer les conclusions. Quant à Amélie Oudéa-Castéra, ses enfants y sont scolarisés, ce qui l’a immédiatement plongée dans un conflit d’intérêts dans lequel elle s’est engluée.
Mediapart en justice
Un journalisme indépendant qui ne cède pas.
Mediapart défend régulièrement son travail journalistique devant le tribunal judiciaire dans le cadre de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, véritable « code de la route » de l’expression journalistique et citoyenne.
Cette juridiction indépendante et impartiale est, en effet, chargée par la loi de protéger le droit du public d’être informé sur des sujets d’intérêt général en appréciant, suivant un subtil contrôle de proportionnalité, si des abus de cette liberté ont été commis.
Mediapart, dont la défense est principalement assurée par le cabinet Seattle avocats, ainsi que, pour certains dossiers, par Me Jean-Pierre Mignard, a été confronté à environ 300 procédures judiciaires depuis sa création en 2008.
À ce jour, cinq condamnations pénales définitives ont été prononcées à notre égard pour :
- une erreur matérielle dans un article rectifiée dès sa connaissance ;
- un délai pour le contradictoire insuffisant ;
- des propos contestés d’une interview ;
- un droit de réponse qui n’a pas été publié dans les délais impartis ;
- une base factuelle jugée insuffisante.
Cette défense judiciaire représente, pour Mediapart, un coût annuel d’environ 250 000 euros et un temps important pour nos équipes. Ces procédures sont un moment essentiel pour faire valoir la qualité de nos enquêtes.
La directrice de la publication de Mediapart, légalement responsable du contenu éditorial du journal en ligne, et nos journalistes sont toujours présent·es lors des audiences pour justifier de l’intérêt général des révélations et informations publiées et du caractère sérieux du travail d’enquête journalistique réalisé.
Nous soutenons de manière quasi systématique la vérité des faits supposés diffamatoires par la production d’une offre de preuves, moyen de défense qui n’est, de manière générale, que très exceptionnellement retenu par les juges, non pas pour des raisons tenant à l’inexactitude des faits révélés par nos enquêtes, mais du fait de ses conditions jurisprudentielles d’admission.
Nous opposons, en conséquence, notre « bonne foi » reposant sur la démonstration du fait que notre article représente pour le public un sujet d’intérêt général, que nous disposions au moment de la publication de l’article d’une base factuelle sérieuse et suffisante, que nous avons respecté le contradictoire, que nous avons été prudents et modérés dans l’expression et que nous n’avions pas, vis-à-vis des personnes citées, d’animosité personnelle.
Pour financer notre prochain impact…
Abonnez-vous !
Mediapart met à la disposition de ses abonné·e·s un espace de contributions personnelles dénommé le Club, à la fois plateforme de blogs et réseau social.